O mie noua sute optzeci si patru - George Orwell, Polirom, 2016
==========================================================
La retraduction de «1984» est une idée fabuleuse
http://www.slate.fr/story/191001/traductrices-1984-orwell-metier-traduction-josee-kamoun-amelie-audiberti
- 1950
- 1984
1984 - Collection "Folio", 1984 - Traduction de Amélie Audiberti, Poche –
1 janvier 1984
(première ed. 1950)
=================================
1984 (Français) Broché – 2018
de George Orwell (Auteur), Josée Kamoun (Traduction)
==============================================
La retraduction de «1984» est une idée fabuleuse
Bérengère
Viennot — 30 mai 2020 à 11h08
La nouvelle
version francophone du chef-d'œuvre d'Orwell par Josée Kamoun est sortie jeudi
28 mai en édition de poche. Cela rend-il le travail d'Amélie Audiberti caduc?
Il est utile
de retraduire 1984 à destination du public de 2020 pour, entre autres, une
question de modernité.
Presque
soixante-dix années se sont écoulées entre les deux versions françaises de
1984. La plupart d'entre nous avons lu la version traduite en 1950 par Amélie
Audiberti, parfaitement contemporaine de l'œuvre d'origine. La retraduction,
commandée par Gallimard à Josée Kamoun, est sortie en 2018.
Une nouvelle
traduction, pour quoi faire? Dès sa sortie, la version traduite par Kamoun a
été vertement critiquée. Les puristes se sont érigé·es contre ses nouvelles
propositions de traduction: n'a-t-elle pas décidé de transposer le roman au
présent? N'a-t-elle pas transformé les néologismes d'origine dont on s'était fort
bien accommodé pendant soixante-dix ans? La novlangue est devenue le néoparler.
L'Angsoc (pour socialisme anglais) devient Sociang, la double-pensée s'est
transformée en doublepenser. Le slogan du parti, «La guerre c'est la paix, la
liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force», devient «Guerre est
paix, liberté est servitude, ignorance est puissance». Et Big Brother vous y
tutoie.
On peut
continuer l'inventaire sans fin mais il n'a pas d'intérêt. Josée Kamoun est une
bonne traductrice, elle a fait ses preuves et Gallimard a sans doute été bien
inspiré de lui confier cette nouvelle traduction. Ce qui ne veut pas dire qu'on
est obligé d'approuver tous ses choix et d'apprécier systématiquement son
travail. On peut ne pas aimer un plat tout en reconnaissant le talent du
cuisinier ou de la cuisinière.
La
traductrice moderne sait
Cette
retraduction de 1984 est une idée fabuleuse, à plusieurs titres. Elle nous sort
de notre zone de confort littéraire et historique, nous oblige à admettre que
nous détestons le changement pour ce qu'il est, et nous met face à la relation
sentimentale que nous entretenons avec les livres que nous aimons. Le 1984 que
chacun·e a dans le cœur et qui lui est propre porte avec lui l'histoire de sa
lecture, du moment où nous l'avons découvert, la mémoire du frisson d'horreur
qui nous a glacé·es quand nous avons vu Winston trahir Julia et aimer Big
Brother. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le premier roman de science-fiction
qui nous a fait douter de notre avenir. Toucher au texte, c'est aussi refermer
une page de nos vies de lecteurs, de lectrices, et pour beaucoup c'est
insupportable.
Pourquoi
est-il utile de retraduire 1984 pour un public de 2020? C'est bien sûr, aussi,
une question de modernité. La traductrice du XXIe siècle sait un million de
choses que celle de 1950 ignorait. Elle sait la Guerre froide, les dictatures
communistes dans la durée, elle sait l'avènement de la société de surveillance
qui, à l'époque d'Orwell, n'était qu'embryonnaire. Elle sait le maccarthysme,
la réalité alternative de l'Amérique de Trump, et son nouveau langage supposé
façonner une réalité parallèle à laquelle le peuple est sommé de croire.
La
traductrice moderne sait aussi le formidable symbole qu'est devenu Big Brother.
Ni Orwell, ni Amélie Audiberti ne pouvaient se douter, au moment de la parution
de la parabole, qu'il deviendrait cette figure paternaliste brandie aujourd'hui
à la moindre menace de restriction des libertés. C'est peut-être ce qui
explique pourquoi la nouvelle traduction l'a gardé: Big Brother ne s'est pas
transformé en Grand Frère sous la plume de Kamoun (ne riez pas: en espagnol, c'est
Gran Hermano; en allemand, c'est Große Bruder).
La seule
manière d'accéder à un texte dans sa pureté, c'est de le lire dans la langue
dans laquelle il a été écrit.
Certes, on
peut cultiver un certain purisme et se dire que puisque Orwell n'avait pas connaissance
de tous ces faits historiques qui nous sont familiers, alors c'est le trahir
que d'en tenir compte en traduisant un texte qui était vierge de ce passé. Mais
c'est oublier qu'une traduction est une réécriture, et que jamais elle n'est
une réplique totalement fidèle du texte original. Oui, la traductrice est une
traîtresse, mais c'est une traîtresse utile et nécessaire, qui ajoute un
fragment quasi invisible de son humanité à l'œuvre dont elle a la charge.
La seule et
unique manire d'accéder à un texte dans toute sa pureté, c'est de le lire dans
la langue dans laquelle il a été écrit, et nul ne peut lire dans toutes les
langues. Faut-il alors renoncer à tous les livres? Même en lisant un ouvrage
dans sa propre langue, jamais le lecteur ou la lectrice n'a accès à
l'intégralité du sous-texte et des intentions que l'auteur ou l'autrice y aura
mises. D'un invidivu à un autre, chaque livre a un sens et une interprétation
différentes. Et la subjectivité qu'exerce la personne qui traduit sur le texte
est celle d'un super-lecteur, qui servira de prisme au déchiffrage du lecteur
final.
De l'ombre
à la lumière
C'est aussi
une idée géniale de retraduire 1984, parce que cela permet, et ce n'est pas si
souvent, de mettre en avant le métier de traducteur. Pour le coup, Josée Kamoun
est un mauvais exemple, car en tant que traductrice de grands écrivains comme
Philip Roth, c'est probablement une des plus médiatiques de toutes. Pourtant,
au-delà de la personne, c'est le travail de traduction littéraire qui est
exposé.
La
traductrice est une conteuse au même titre que l'auteur ou l'autrice du livre,
à la différence qu'elle ne fait que répéter l'histoire de quelqu'un d'autre. Cette
dernière ne lui appartient pas puisqu'elle n'en est pas la créatrice, mais le
temps de la traduction, elle la transforme et lui donne un peu de son âme, un
peu comme les griot·tes qui, génération après génération, racontent les mêmes
histoires, imperceptiblement modifiées par la personnalité de l'individu qui
raconte et de ceux qui écoutent. Retraduire 1984, c'est permettre à cette
histoire d'être racontée par une autre, par l'héritière littéraire de la
première femme à l'avoir portée et donnée à lire au public francophone.
Tout ou
presque a été dit sur cette retraduction de 1984 par Josée Kamoun. Par la
traductrice elle-même, par des critiques littéraires, par des internautes sur
les réseaux sociaux. Dans le battage médiatique autour de ce livre magistral,
il m'a semblé qu'il y avait une grande absente. Celle qui a inventé le mot
«novlangue», celle qui a décidé que «Big Brother» serait gardé en français et
grâce à qui ce mot désigne une réalité qui à chaque époque garde le même
référent littéraire. Celle aussi qui m'a fait découvrir ce livre fantastique, à
moi et à des millions de francophones entre 1950 et 2018.
Amélie
Audiberti, c'est un nom familier, mais qui la connaît?
«Une
traductrice idéale»
C'est avant
tout une «femme de». On ne présente plus Jacques Audiberti, écrivain, poète,
dramaturge, essayiste... Audiberti, c'est aussi le nom de jeune fille et de
plume de Marie-Louise, fille d'Amélie (en réalité Élisabeth Cécile Amélie) et
de Jacques. Marie-Louise, qui est romancière, essayiste, critique littéraire
et, tiens, traductrice. Elle habite à Paris, elle a 92 ans et elle a accepté de
me parler de sa mère, l'Arlésienne de 1984.
Comme il est
grand, le contraste entre les destins des deux traductrices d'Orwell. Comme
Josée Kamoun, Amélie Audiberti a traduit des dizaines d'auteurs parmi les plus
talentueux. Orwell, bien sûr, mais aussi Olaf Stapledon, Kenneth Bulmer et
Isaac Asimov, entre autres. Mais elle n'est pas passée à la radio, ni à la
télévision. Les journalistes ne lui ont jamais demandé de commenter ou de
justifier ses choix de traduction. Amélie Audiberti appartenait à cette
génération de traducteurs et de traductrices invisibles qui exerçaient un
talent qu'on n'appelait pas encore un métier. «Personne n'est allé vers elle,
et elle trouvait ça tout à fait normal», commente sa fille.
Amélie
Audiberti était «extrêmement discrète et n'avait aucun besoin de
reconnaissance».
Marie-Louise
Audiberti
C'est son
mari qui lui a obtenu cette commande de traduction par la maison Gallimard.
Elle n'était pas novice, mais, me confia sa fille, «ce fut un gros travail».
Elle écrivait d'abord tout à la main, avant de finaliser sa traduction à la
machine. «Elle tapait très très bien, cela faisait l'admiration de mon père»,
se rappelle Marie-Louise.
«Petite main»
grattant le papier dans l'ombre de son mari et du géant Orwell, Amélie
Audiberti a vécu largement assez longtemps pour constater le phénoménal succès
et la facette politique visionnaire de l'œuvre qu'elle avait traduite. En
a-t-elle ressenti de la fierté, ou du ressentiment, devant un succès qui lui
était en partie imputable sans qu'elle puisse en revendiquer grand-chose?
D'après Marie-Louise, Amélie était «une traductrice idéale», c'est-à-dire que
non contente d'être invisible de nature, elle s'en satisfaisait absolument,
elle était «extrêmement discrète et n'avait aucun besoin de reconnaissance».
Passionnée de
langue anglaise, Amélie Audiberti n'avait pas de formation de traductrice –cela
ne se faisait pas à l'époque. Il suffisait de parler plusieurs langues et, bien
entendu, de parfaitement maîtriser sa langue maternelle. Amélie était
institutrice; elle était mariée à un homme de lettres, elle aimait voyager
seule en Angleterre et entretenait une passion pour la langue anglaise. Amélie
était une femme discrète et secrète, qui était «consciente que ce livre était
un événement, que c'était très important», mais qui, lorsqu'il a été publié et
qu'il a connu le succès que l'on sait, «a été contente qu'il soit fini, qu'il
soit bien, qu'il plaise». Et puis c'est tout.
Amélie a
livré un texte qui, bien sûr, est plus approximatif que ce qu'un traducteur
muni des outils et des savoirs de notre époque est capable de produire. Mais
comme le dit sa fille, «elle traduisait en écrivain, comme moi, comme mon
père». Amélie a permis à des millions de lecteurs et de lectrices de plonger
dans Orwell et de découvrir une histoire à la fois belle et terrifiante, un
avertissement et une prédiction; et dans toute l'imperfection de sa traduction,
elle a mis un peu d'elle-même, comme nous le faisons tous et toutes quand nous
traduisons.
Et si l'œuvre
de Josée Kamoun est moderne, vive, tranchante, adaptée à un lectorat du XXIe
siècle, si elle lui ressemble et est peut-être destinée à devenir la référence
des générations futures, elle aussi porte en elle, dans ce qu'elle a rejeté
comme dans ce qu'elle a repris, la version d'Amélie.


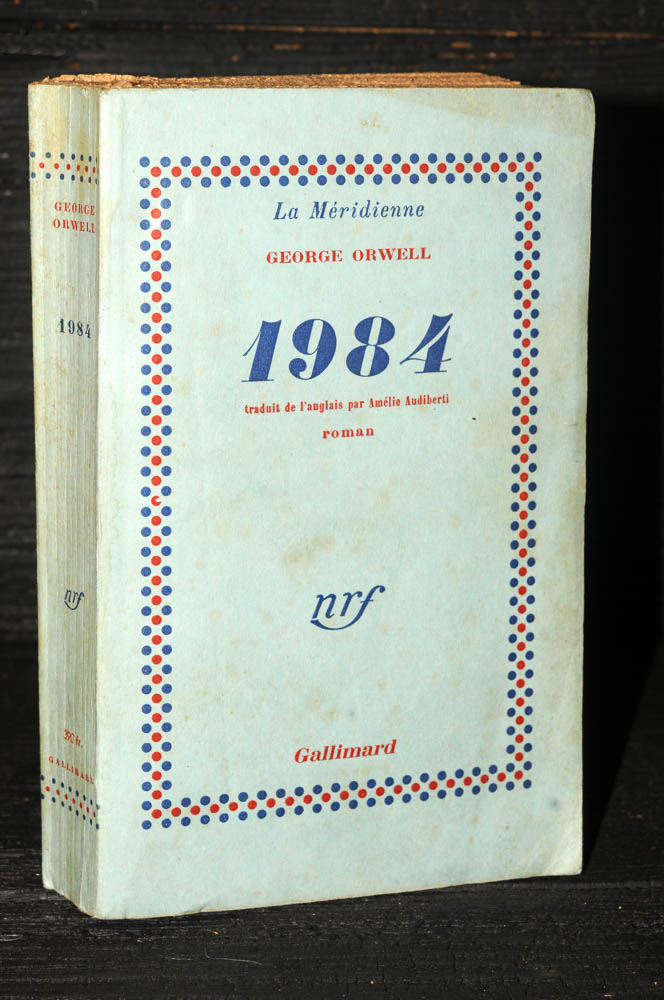
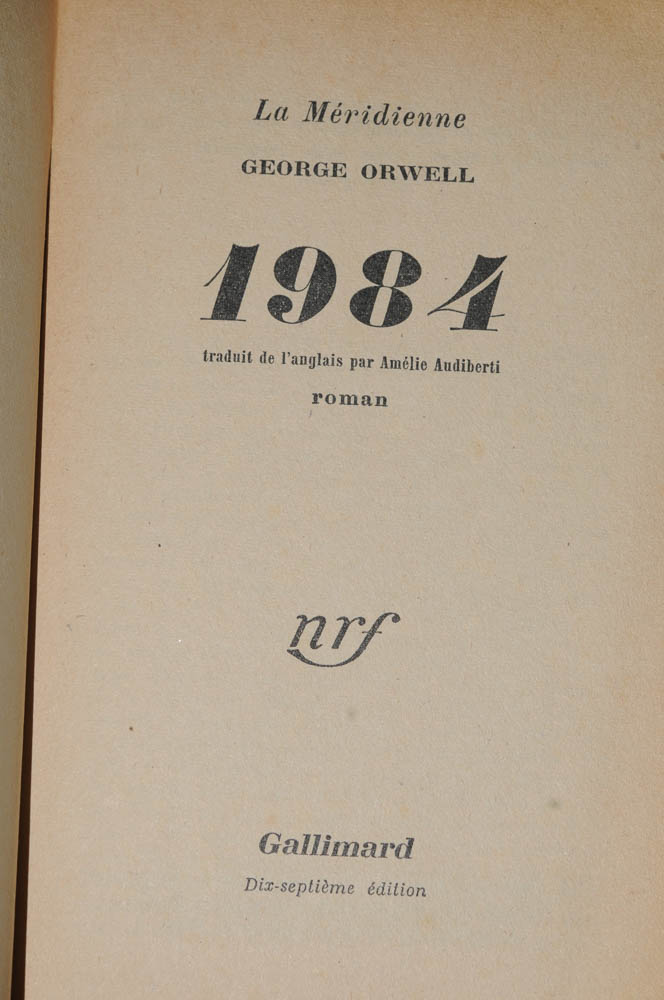
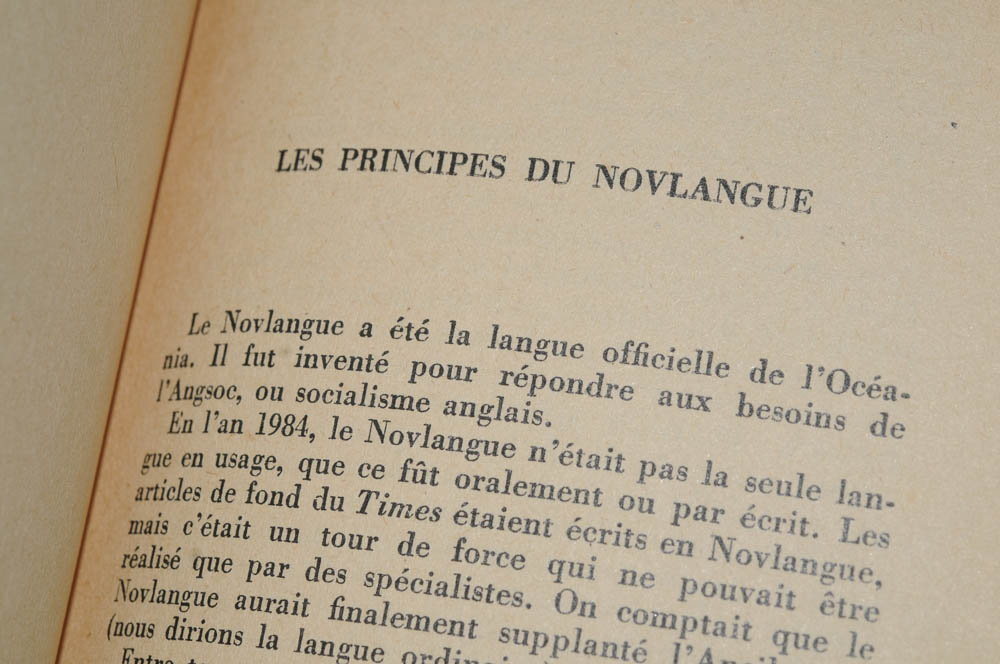
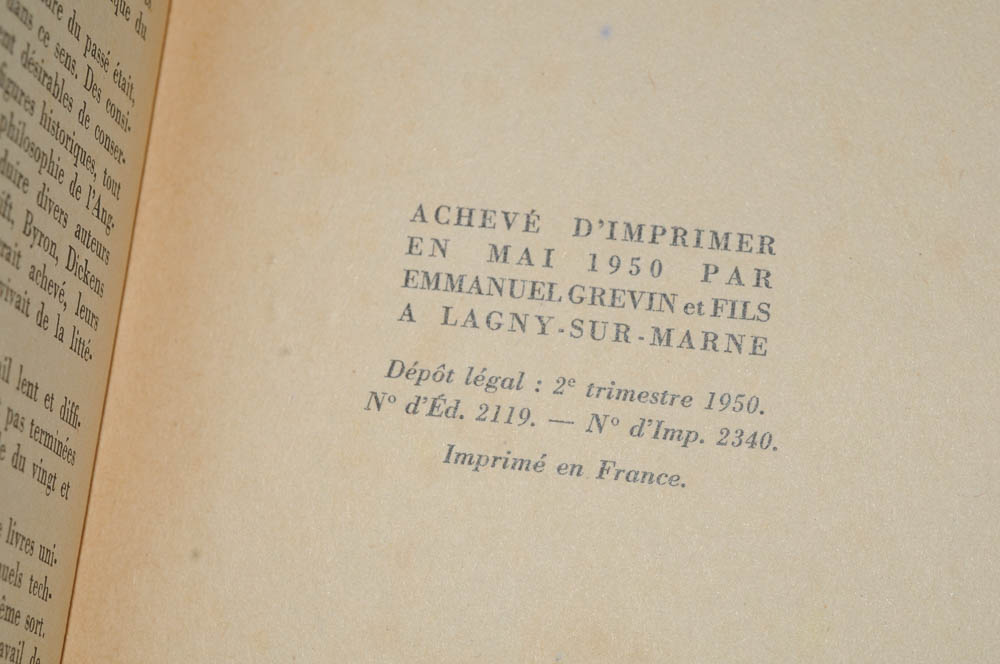


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu